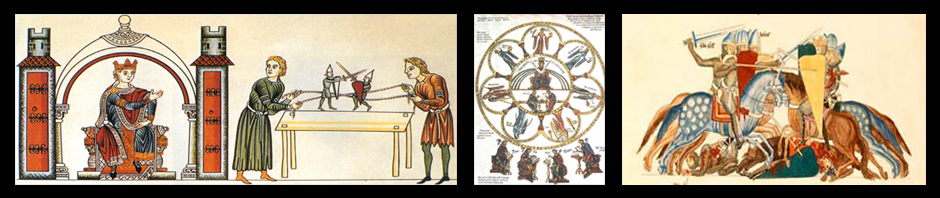LABHARDT (Robert), Krieg und Krise, Basel 1914-1918, Beiträge zur Basler Geschichte, Bâle, Christian Merian Verlag, 2014, 352p.
Bâle durant la première guerre mondiale. A la fois représentative de l’histoire suisse et singulière comme à son habitude. C’est que Bâle est ville frontière, si proche du théâtre d’opération et des âpres combats qui se déroulent dans les Vosges, et en même temps condamnée à une forme de neutralité qui d’habitude sied à nos amis Suisses mais difficile à vivre quand une partie du pays, les Romands, penchent pour la France et la Belgique, et les Suisses allemands auraient tendance à placer leur sympathie du côté de l’Empire allemand et autrichien. L’excellente et bienvenue étude de Robert Labhardt met tout cela en perspective et montre combien Bâle a souffert du plus effroyable des conflits et comment, d’un autre côté, elle a tiré des leçons d’un management de crise qui allait lui être profitable quand, vingt ans plus tard, éclata la seconde guerre mondiale. La guerre de 14 ne fut pas pour notre voisine un long fleuve tranquille. S’y réveillèrent et se révélèrent quelques antagonismes profonds notamment sociaux entre classe dominante qui continua à faire des affaires, en particulier l’industrie chimique en plein essor, et classe laborieuse, appauvrie, affamée – on songe notamment aux innombrables problèmes de ravitaillement et à la bataille des pommes de terre – et vindicative qui participa pleinement à la fameuse grève nationale (Landessstreik) de 1918. Non, malgré les dangers encourus Bâle ne respire pas la cohésion sociale : l’égoïsme des uns côtoie la générosité et la compassion des autres, notamment vis-à-vis des Alsaciens voisins, en plein dans l’œil du cyclone. Le modèle bâlois, ce mélange entre libéralisme économique et bienfaisance sociale, est mis à mal. Les convictions religieuses ou tout simplement la foi qui faisait le ciment de la société sont ébranlées. Comment accepter que c’est le même Dieu qu’on implore de part et d’autre des belligérants avant d’aller au combat ? Si la polarisation s’est installée au sein de la société, il demeure cependant une façon toute bâloise d’appréhender les événements : cette conscience diffuse mais réelle d’une situation privilégiée au sein d’un environnement chaotique qui explique pourquoi les uns et les autres, même dans leurs affrontements, entourent leurs relations conflictuelles d’un peu d’indulgence et de patience. Hommes politiques, chefs d’entreprises, ouvriers contestataires ne poursuivent pas le même but, c’est le moins que l’on puisse dire, mais la mesure est devenu leur credo et la science du compromis une vertu. Ils avaient tous la conscience de la fragilité de leur situation que leur enviait une bonne partie de l’Europe en guerre. Probablement savaient-ils également que la Suisse était nécessaire aux belligérants, en tant que lieu de rencontre diplomatique et d’espionnage, de plateforme économique et de centre d’accueil humanitaire.
Gabriel Braeuner, été 2015, recension pour la Revue d’Alsace 2015